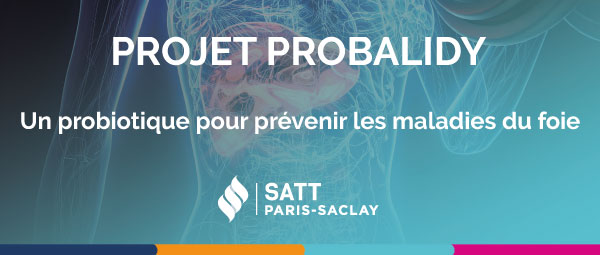![]()

Comment rendre l’évaluation du risque sismique plus accessible, plus précise et basée sur la modélisation physique pour les professionnels ?
C’est le défi que relève le projet EASYRISK, en s’appuyant sur des outils numériques puissants mais simplifiés d’usage. L’objectif : rendre l’évaluation du risque sismique régional site-spécifique plus précise et surtout plus accessible pour les assureurs et les ingénieurs.
Un projet de recherche devenu innovation deeptech grâce aux investissements et accompagnement de la SATT Paris-Saclay.
► Comment est née l’idée d’EASYRISK et à quel besoin précis répondait-elle initialement ?
Filippo Gatti : L’idée d’EASYRISK est le fruit de plusieurs années de développement. Depuis plus de 10 ans, nous développons, au sein de l’équipe, code open source (SEM3D), conçu principalement pour des projets liés aux études de protection parasismiques d’infrastructures critiques, telles que les centrales nucléaires. Ce code, développé par le Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay du CEA, l’Institut de Physique du Globe de Paris et le CNRS, bien que très performant, présente une complexité technique importante. À l’arrivée d’un nouveau collègue, doctorant ou post-doctorant, un long processus d’onboarding est nécessaire. Il faut maîtriser un langage de programmation ancien (Fortran90) et avoir à la fois des compétences poussées en informatique et une bonne compréhension du domaine d’application. Or, ces connaissances préalables sont rarement homogènes.
À force de répéter ce transfert de compétences, nous avons pris conscience que cette complexité représentait un frein, non seulement pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour une utilisation du code en dehors du cadre académique, dans des contextes professionnels ou commerciaux.
L’objectif était de conserver le moteur de calcul performant que nous avions co-développé, tout en construisant autour de ceci une plateforme intégrée, ergonomique, et accessible.
Côté scientifique, il s’agissait donc de démocratiser l’usage de ces outils. Et côté commercial, nous avons rapidement identifié un besoin chez certains acteurs comme les assureurs ou les entreprises d’ingénierie spécialisées dans l’évaluation des risques sismiques à l’échelle régionale. Nous avons alors compris que le principal verrou était d’ordre purement technique, ce que nous avons voulu lever avec EASYRISK.
► Le type d’utilisateur visé est donc principalement un assureur, c’est bien ça ?
F.G. : Effectivement, plusieurs travaux ont montré que les outils comme EASYRISK présentent un réel intérêt pour l’évaluation du risque sismique dans le secteur de l’assurance. Cela dit, même si les grands groupes d’assurance disposent généralement de départements R&D bien équipés et compétents, ils utilisent rarement ce type de code, uniquement pour des études très spécifiques. Cela s’explique sans doute par plusieurs facteurs. D’abord les technologies de calcul scientifique – notamment via le cloud – ont connu une forte évolution ces dix dernières années, les rendant bien plus accessibles qu’auparavant. Mais malgré ces avancées, les pratiques industrielles, notamment dans le secteur de l’assurance, restent ancrées dans une expertise fondée sur des décennies d’études empiriques à partir de données enregistrées.
L’introduction de signaux sismiques simulés représente un changement de paradigme potentiellement source de biais, ce qui peut freiner leur adoption. D’autant que ces simulations ont un coût non négligeable, qu’elles soient réalisées via le cloud ou sur des infrastructures de calcul intensif (HPC). Enfin, les outils utilisés – comme le simulateur SEM3D – nécessitent des compétences avancées, parfois complexes à mobiliser en dehors du milieu académique, ce qui peut décourager leur intégration dans la pratique courante.
Ensuite pour un assureur, l’investissement humain et les compétences internes sont conséquents. C’est pourquoi, EASYRISK apporte un accès simplifié aux simulations complexes.
Enfin, il faut bien comprendre que les assureurs ont des experts de calcul, mais cela n’empêche pas que leur cœur de métier soit : l’évaluation, la modélisation et la gestion des risques. C’est pourquoi nous avons voulu concevoir une solution qui les recentre sur ce qui les intéresse vraiment : les résultats, exploitables directement pour leurs analyses.
Cela dit, les entreprises d’ingénierie peuvent aussi faire partie des utilisateurs potentiels. Les grands groupes qui disposent de départements R&D très avancés, mènent déjà leurs propres calculs complexes. Pour eux, EAYSRISK peut être utile, mais dans un cadre plus ciblé, comme par exemple pour affiner des simulations existantes, notamment dans des projets de grande ampleur comme les centrales nucléaires.
Les entreprises d’ingénierie civile sont contraintes par des normes règementaires strictes (les Eurocodes), qui ajoutent des contraintes fortes sur les choix de modélisaiton. EASYRISK peut donc représenter un outil de prototypage à des fins de vérifications, d’analyse, de sensibilité et d’analyse probabiliste de la vulnérabilité sismique de ces ouvrages.
► Concrètement, qu’apporte votre approche par jumeau numérique et simulation physique par rapport aux outils empiriques actuellement utilisés dans l’estimation du risque sismique ?
F.G. : J’ai déjà en partie répondu à cette question, mais pour résumer : les approches empiriques utilisées actuellement par les assureurs reposent essentiellement sur des données sismiques enregistrées historiquement. Ces modèles fournissent des formules empiriques, basées sur des régressions statistiques sur les événements passés, pour estimer les mesures d’intensité associées à un scénario sismique potentiel.
Ces modèles empiriques ne prennent en compte que très marginalement la complexité physique du phénomène, notamment les effets site-spécifique, qui sont souvent pris en compte de manière simplifiée. L’exposition au risque sismique dépend aussi de l’impact potentiel associé, et cela nécessite une étude plus raffinée dans le cas d’ouvrages critiques (centrales nucléaires, ouvrages ferroviaires…).
Par exemple, en France, plusieurs sites industriels très importants sont implantés dans la vallée du Rhône, à proximité d’un système de failles actives très connu et étudié en France métropolitaine. La caractérisation assez précise et la connaissance approfondie de ces failles justifient pleinement l’usage d’outils de simulation plus poussés.
Enfin, un dernier point, plus stratégique, est apparu récemment : une grande partie des bases de données sismiques utilisées à l’échelle mondiale sont hébergée à l’étanger. Dans un contexte géopolitique tendu, cette dépendance pose question. Si l’accès à ces données était un jour restreint, nos outils numériques permettraient de démontrer une autonomie stratégique importante.
C’est là que notre approche par jumeau numérique entre en jeu. Elle permet de générer des scénarios hypothétiques – des tremblements de terre que l’on n’a encore jamais observés mais qui sont plausibles et dont on peut simuler la physique précise.. Une fois qu’un modèle numérique est calibré à partir de données historiques, il peut simuler des séismes potentiels réalistes en intégrant la géologie locale, les failles actives, et d’autres paramètres. On peut alors tester différentes configurations : un seul segment de failles, plusieurs simultanément… Cela offre une finesse d’analyse bien supérieure, et permet de mieux estimer les marges de sécurité associées aux infrastructures critiques.